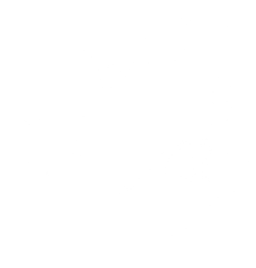L’écriture, une pratique thérapeutique pour le psychotrauma ?
Quels points communs entre Simone Veil, Boris Cyrulnik, Georges Semprun, Primo Levi, Louis-Ferdinand Céline, et, plus près de nous, Grand Corps Malade ou encore Philippe Lançon ? Tous ont vécu une expérience traumatique et en ont fait un sujet d’écriture. Faut-il voir dans l’écriture un processus d’intégration voire de dépassement du traumatisme ? De nombreuses recherches ont étudié les bienfaits, les mécanismes à l’œuvre et les différents protocoles d’une écriture qui se voudrait thérapeutique.
L’écriture, une pratique thérapeutique ?
Il n’existe pas de définition consensuelle et globale de l’écriture thérapeutique. Pour Kerner et Fitzpatrick (2007), le terme d'écriture thérapeutique décrit tout exercice d'écriture entrepris pour soutenir le travail thérapeutique. Selon Wright (2004), il s’agit d’une écriture expressive et réflexive réalisée par un client de sa propre initiative ou sur suggestion d’un thérapeute ou d’un chercheur.
L'écriture est de plus en plus utilisée comme outil thérapeutique dans les milieux cliniques, notamment auprès de sujets souffrant de troubles psychiques. Elle présente certains avantages tels que simplicité d’accès, facilité de mise en œuvre et faible coût (Baker, 2009). De plus, papier et stylo sont toujours disponibles tandis que l’interaction avec un thérapeute est limitée dans le temps (Bolton, 2004). Ajoutons que l’écriture peut être une première étape d’exploration et d’expression de pensées inavouées avant de les partager, grâce à la médiation de l’écrit, avec un thérapeute ou avec autrui (Bolton et Latham, 2004).
L’écriture thérapeutique ne saurait être envisagée comme un processus artistique mais comme une forme particulière de communication, avec soi et/ou avec autrui, et comme un développement de la pensée et de la conscience. Ce qui est en jeu, c’est le processus d’écriture plutôt que le texte produit (Bolton, 2004).
Bénéfices de l’écriture thérapeutique
En premier lieu, l’écriture crée du lien et redonne du sens. L’écriture est « un tissage de la fracture spatio-temporelle provoquée par le traumatisme psychique » (Chidiac et Barrois, 2015, p.303), « un moyen de recoller les morceaux de la fragmentation traumatique » (Tellier, 1998, p.84). Duchin et Wiseman (2019) évoquent, à propos de survivants de l’Holocauste ayant rédigé leurs mémoires, la capacité à passer d’une absence de représentation verbale du traumatisme à une représentation narrative de leur histoire grâce à l’écriture. Cette discipline « favorise une reconstruction psychique » (Chidiac, 2013, p. 32) et facilite une unification du sens de Soi (Baker, 2009 ; Chidiac, 2013).
De plus, l’écriture autorise la mise à distance des souffrances du sujet (Chidiac, 2013 ; Tellier, 1998) ainsi qu’une re-familiarisation avec les sensations corporelles liées au vécu émotionnel (Baker, 2009).
Enfin, l’écriture libère la parole au sujet des événements traumatiques et aide à en établir une narration partageable, ce qui en fait un moyen de reconnexion sociale (Uy et Okubo, 2018). Et ce d’autant plus que la divulgation de ses écrits voire leur publication donnent à l’individu le sentiment de pouvoir être mieux compris par autrui (Duchin et Wiseman, 2019).
Les méthodes d’écriture thérapeutique sont variées : tenue d’un journal, poésie, narrations autobiographiques ou fictionnelles, écriture créative, seul ou en groupe. Les dispositifs d’écriture thérapeutique peuvent être classés sur un continuum. D’un côté, les méthodes non structurées et abstraites relevant d’une psychologie humaniste trouvent leur expression dans l’écriture créative et la poésie. À l’autre extrémité du spectre, les méthodes structurées et concrètes rattachées au courant cognitivo-comportemental et scientifique sont représentées par l’écriture expressive (Kerner et Fitzpatrick, 2007 ; Wright, 2004).
L’écriture expressive
L’écriture expressive a été conçue et conceptualisée par Pennebaker (1989, 2013) en tant qu’outil d’expression des émotions engendrées par des événements bouleversants voire traumatiques. L’intervention classique préconisée par Pennebaker (1989, 2013) consiste en une session d’écriture quotidienne de vingt minutes sans s’arrêter et ce, durant quatre jours consécutifs. Ces écrits sont réalisés par le sujet seul, en un lieu choisi par lui. Ils n’ont pas vocation à être partagés et peuvent donc être détruits à l’issue des quatre sessions d’écriture. Pour chaque session d’écriture, la consigne est identique : elle invite le sujet à explorer par écrit l’événement traumatique, les émotions et pensées qui y sont associées ainsi que la façon dont il l’a affecté.
« Votre objectif est d'écrire sur vos pensées et sentiments les plus profonds au sujet du traumatisme ou du bouleversement émotionnel qui a le plus influencé votre vie. Dans votre écriture, lâchez prise et explorez l'événement et la manière dont il vous a affecté. » (Pennebaker, 2013, p.26)
La méta-analyse de Frattaroli (2006) recense cinq théories invoquées pour rendre compte des effets de l’écriture expressive.
En premier lieu, la théorie de la désinhibition stipule que l'inhibition des pensées et des émotions concernant un événement traumatique est délétère tant d’un point de vue physiologique que psychique. Par conséquent, l'expression des pensées et émotions inhibées peut réduire le stress et améliorer la santé physique et psychologique (Pennebaker et Smyth, 2016). Or, l’écriture expressive est un moyen de divulgation émotionnelle facilement accessible, sans les contraintes de la communication interpersonnelle qui peuvent freiner l’expression des émotions (Kerner et Fitzpatrick, 2007).
Deuxièmement, la théorie de l’auto-régulation identifie les émotions comme un retour d’information sur l’atteinte des objectifs d’un sujet (King, 2002). Une bonne régulation émotionnelle permet de modifier les comportements ou les buts afin de réduire la tension occasionnée par des objectifs non réalisés. Cependant, les expériences traumatiques perturbent le processus normal d’autorégulation. Le système émotionnel est suractivé en permanence et envoie des messages qui ne sont pas interprétables en termes de buts atteints ou non-atteints (King, 2002). Dans ce cadre, l’écriture expressive est un moyen d’explorer les émotions et leurs origines, de clarifier les objectifs de l’individu et ainsi, de normaliser le processus d’autorégulation (Lepore et al., 2002).
Par ailleurs, la théorie du traitement cognitif suggère que l’écriture expressive est un moyen de mieux comprendre un événement traumatique, de lui donner un sens et de l’intégrer dans le schéma cognitif du sujet (Lutgendorf et Ullrich, 2002). Un processus de restructuration cognitive se met en place, permettant au sujet de modifier sa perception de la situation traumatique et de ses propres réponses (Lepore et al., 2002). Ce traitement cognitif se manifeste par une augmentation, au cours des sessions d'écriture, de l'utilisation de mots reflétant une causalité (ex : parce que, cause, effet, résulter, raison) et une compréhension (ex : réaliser, comprendre, penser, considérer, savoir) (Pennebaker et Francis, 1996 ; Pennebaker et Smyth, 2016). Ces indicateurs de relations causales et de prises de conscience reflètent l’élaboration d’un schéma narratif conférant un sens à l’événement traumatique (Park, 2010 ; Pennebaker et Smyth, 2016 ; Smyth et al., 2001).
De plus, la théorie de l’exposition compare l’expression écrite des pensées et émotions relatives à un événement traumatique, aux thérapies par exposition. Lorsqu’une personne décrit et revit, de façon répétitive, une expérience aversive, cette répétition descriptive et émotionnelle conduit à un processus d’habituation allant jusqu’à l'extinction de ces pensées et émotions (Lepore et al., 2002).
Notons enfin la théorie de l’intégration sociale, qui stipule que l’écriture expressive améliore les interactions des individus avec leur environnement social (Pennebaker, 2013). En effet, l’intégration d’un récit structuré, simplifié et compréhensible entraîne une diminution des ruminations, ce qui libère en partie la mémoire de travail, réduit l’état de stress et permet au sujet d’accroître bénéfiquement ses relations avec autrui (Pennebaker et Smyth, 2016). Kovac et Range (2000) relèvent que les sujets pratiquant l’écriture expressive ont tendance à évoquer davantage leur expérience traumatique avec leur entourage dans les semaines ou mois qui suivent l’intervention.
Les très nombreuses recherches sur ce protocole d’écriture thérapeutique qu’est l’écriture expressive montrent des effets bénéfiques tant au niveau physiologique que psychologique ou encore cognitif (Frattaroli, 2006 ; Smyth, 1998). Dans le cadre du psychotraumatisme plus spécifiquement, l’écriture expressive montre des effets bénéfiques sur les symptômes du TSPT (Smyth et al., 2008).
Cependant, le principe de l’écriture expressive n’est pas adapté à tous les sujets. La focalisation sur le souvenir traumatique peut en effet soulever des mécanismes de défense afin d’éviter la confrontation avec la souffrance qu’il occasionne (Baker, 2009). Dès lors, les ateliers d’écriture thérapeutique peuvent être un moyen détourné d’aborder le psychotraumatisme (Baker, 2009 ; Chidiac, 2013).
Les ateliers d’écriture thérapeutique
Un atelier d’écriture thérapeutique est un dispositif groupal dans lequel un psychothérapeute-animateur énonce des consignes – thème et forme d’écriture – à partir desquelles les patients vont composer dans un temps donné (Chidiac, 2013). Le thème d’écriture peut être fictionnel et de forme libre, par exemple « Un meurtre sans importance » (Chidiac, 2013, p. 159), ou autobiographique avec une contrainte littéraire, par exemple « Un événement marquant de votre vie : un haïku décrivant votre vie avant cet événement ; un haïku en décrivant l’après » (Chidiac, 2013, p. 160). Chaque texte est ensuite lu par son auteur, lecture qui donne lieu à un retour de la part des participants et de l’animateur de l’atelier (Chidiac, 2013 ; Mégrier et Hamot, 2017).
Chidiac (2019) assigne quatre objectifs aux ateliers d’écriture thérapeutique : l’expression des pensées et émotions, la communication au sein d’un collectif, l’élaboration des pensées et la découverte du changement souhaité. Ces ateliers s’adressent à tout type de population, enfants et adultes, quelle que soit leur pathologie, somatique ou psychique.
Les mécanismes à l’œuvre dans les ateliers d’écriture thérapeutique peuvent être classés en deux catégories : les mécanismes liés au cadre groupal et les mécanismes liés à l’écriture créative.
« Le groupe […] est un lieu d’échange, de rencontre, de partage et de communication à un double niveau -cognitif et émotionnel. Il permet le dépassement de soi, de sa propre timidité à lire les textes devant les autres, et la confrontation à différentes formes de pensées. » (Chidiac, 2013, p. 31).
D’un point de vue psychanalytique, on peut observer des phénomènes de transfert de chaque participant vers le thérapeute, vers le reste du groupe et même vers les personnages fictionnels créés dans les textes (Chidiac, 2013). D’un point de vue cognitivo-comportemental, le groupe permet un apprentissage social par imitation (Chidiac, 2013). Par ailleurs, les activités de groupe dans un espace sécure mettent en place les structures permettant de nouer des relations sociales saines et de construire des techniques adaptées d’interaction sociale (Lauer et Goldfield, 1970). Ce processus est renforcé par les activités artistiques créatives qui servent de médiation aux échanges entre les membres du groupe et enrichissent les interactions (van Westrhenen et al., 2017).
Quant à l’écriture créative, elle facilite la compréhension de soi par la révélation de pensées jusque-là inconscientes (Hilse et al., 2007 ; Lauer et Goldfield, 1970). La fiction peut constituer une protection en créant « des enclaves sécures quand l’effroi revient avec trop de force » (Benestroff, 2017, p. 377). Mais cette écriture créative favorise également un assouplissement psychique par un mouvement entre le créatif et l’intime, entre l’imaginaire et l’autobiographique (Chidiac, 2013).
Progressivement, ce qui était impensable commence à s’écrire. L’écriture s’avère alors cathartique, avec une décharge émotionnelle de l’expression de la souffrance. Puis, grâce aux contraintes que représentent les consignes d’écriture, le sujet peut progressivement passer d’une écriture cathartique à une phase d’élaboration créative (Chidiac, 2013). Alors que le traumatisme est porteur d’une rupture de sens, l’écriture rétablit un lien. L’écriture passe dans une forme narrative, avec une mise en récit du traumatisme et du sens qui lui est attribué (Liu, 2013). Cette représentation du traumatisme sous forme narrative devient alors partageable (Bolton, 2008 ; Chidiac, 2013).
Nous identifions principalement deux bénéfices relevant de la croissance post-traumatique à l’issue d’ateliers d’écriture thérapeutique.
Premièrement, une plus grande conscience de ses propres forces peut émerger. Renforcement de l’estime de soi, développement d’une plus grande autoréflexivité, sentiment d’accomplissement et d’actualisation de soi, accroissement de la confiance en soi par la découverte de sa capacité à écrire (Bolton, 2008 ; Chidiac, 2013 ; Lauer et Goldfield, 1970 ; Nicholls, 2009), tels sont des effets recensés dans le cadre des ateliers d’écriture thérapeutique. Ils trouvent leur source non seulement dans l’écriture mais également dans les retours des autres participants (Chidiac, 2013).
Deuxièmement, le développement de relations plus chaleureuses avec autrui peut également se développer à l’issue des ateliers. En effet, la dynamique de groupe fournit une opportunité de regagner une confiance en autrui que le traumatisme a pu ébranler voire anéantir. Ainsi, pour le sujet qui s’est isolé en raison de son traumatisme, les ateliers d’écriture deviennent un lieu d’échange dans un retour à l’altérité (Usbeck, 2018). De ces rencontres avec l’Autre peuvent résulter une facilitation d’une divulgation de l’événement traumatique et une amélioration des relations sociales (Bolton, 2008 ; Liu, 2013).
L’écriture en atelier à visée thérapeutique semble donc prometteuse en regard des problématiques rencontrées par les sujets souffrant de psychotraumatisme. Néanmoins, le caractère groupal des ateliers d’écriture thérapeutique ne convient pas à tous les sujets. Chidiac (2013) évoque au moins trois contre-indications : la phobie sociale, les phases maniaques qui peuvent « perturber l’homéostasie du groupe » (p. 66) mais également la récence du traumatisme. Une prise en charge individuelle est alors souhaitable.
La tenue d’un journal thérapeutique
Au milieu du continuum entre interventions structurées et non-structurées, abstraites et concrètes, humanistes et cognitivo-émotionnelles, se trouve la tenue d’un journal dans un cadre thérapeutique. Cette pratique individuelle consiste en un processus d’écriture introspective et analytique (Chidiac, 2013) facilitant le traitement de troubles psychologiques, émotionnels et physiologiques (Adams, 1996). À la différence d’un journal intime dans lequel sont consignés des événements, la tenue d’un journal thérapeutique amène le sujet à dialoguer avec ses pensées et préoccupations dans un processus d’autosoins (Chidiac, 2013 ; Thompson, 2004).
Adams propose une technique progressive de tenue de journal thérapeutique, avec des consignes pratiques et concrètes au début, puis des consignes de plus en plus abstraites (Thompson, 2004). La technique la plus avancée consiste en l’écriture automatique par laquelle le sujet écrit toutes les pensées et idées telles qu’elles parviennent à l’esprit, sans censure (Hildson, 2004).
La tenue d’un journal thérapeutique est une pratique aisément accessible. Elle peut être recommandée par un thérapeute comme adjuvent à la thérapie. En effet, se confier à un journal peut constituer un prélude au partage d’une difficulté auprès d’autrui, y compris d’un thérapeute (Thompson, 2004).
On retrouve dans la tenue d’un journal thérapeutique des mécanismes précédemment évoqués à propos de l’écriture thérapeutique.
Tout d’abord, un journal est un moyen de catharsis, d’expression d’émotions intenses. Il tolère aisément la répétition de récits, sans jugement, à la différence d’un interlocuteur qui aura tendance à se lasser (Thompson, 2004).
Ensuite, on y retrouve un mécanisme d’exposition du sujet à son traumatisme dans un cadre contrôlé par le sujet lui-même. Cette exposition permet d’explorer l’événement traumatique et de lui donner du sens (Creely, 2018).
Enfin, la tenue d’un journal thérapeutique contribue à la croissance post-traumatique dans la mesure où cette pratique soutient un processus de réintégration sociale (Creely, 2018). En effet, pour une personne qui s’est isolée par perte de confiance en autrui, la tenue d’un journal thérapeutique constitue un moyen de développer son intimité avec elle-même. Cette relation à soi constitue une première étape vers la reconnexion à l’Autre (Thompson, 2004). Le journal peut ensuite servir de support au partage du traumatisme avec autrui, en en faisant lire des pages à son thérapeute ou à son entourage. Et lorsque le journal thérapeutique prend la forme d’un blog, l’écriture thérapeutique s’inscrit alors directement dans le partage social (Creely, 2018).
Conclusion
Sans prétendre au statut de thérapie en soi, l’écriture thérapeutique, pratiquée seule ou en groupe, peut renforcer une psychothérapie du psychotraumatisme. Elle offre un cadre autoréflexif qui facilite la relation de soi à soi et la relation de soi à autrui.
Références
Adams, K. (1996). The structured journal therapy assessment: A report on 50 cases. Journal of Poetry Therapy, 10(2), 77-86. https://doi.org/10.1007/BF03391501
Baker, S. (2009). Tell It Slant: History, Memory, and Imagination in the Healing Writing Workshop. Traumatology, 15(4), 15–23. http://dx.doi.org/10.1177/1534765609348912
Benestroff, C. (2017). Jorge Semprun. Entre résistance et résilience. CNRS EDITIONS.
Bolton, G. (2004). Introduction: writing cures. Dans G. Bolton, S. Howlett, C. Lago et J.K. Wright (dir.), Writing cures. An introductory handbook of writing in counselling and therapy (p. 1-3). Routledge.
Bolton, G. (2008). “Writing is a way of saying things I can’t say”. Therapeutic creative writing: a qualitative study of its value to people with cancer cared for in cancer and palliative healthcare. Medical humanities, 34(1), 40-46. http://dx.doi.org/10.1136/jmh.2007.000255
Bolton, G. et Latham, J. (2004). ‘Every poem breaks a silence that had to be overcome’: the therapeutic role of poetry writing. Dans G. Bolton, S. Howlett, C. Lago et J.K. Wright (dir.), Writing cures. An introductory handbook of writing in counselling and therapy (p. 106-122). Routledge.
Chidiac, N. (2013). Ateliers d’écriture thérapeutique. Elsevier Masson
Chidiac, N. (2019). On writing therapy. From Finding Forrester to Imre Kertész, Annales Médico-Psychologiques, 177, 394–403. https://doi.org/10.1016/j.amp.2019.02.006
Chidiac, N. et Barrois, C. (2015). Narration et mémoire. Du survivant à l’écrivain. Annales Médico-Psychologiques ,173, 303–307. https://doi.org/10.1016/j.amp.2014.11.001
Creely, C. (2018). The efficacy of journal writing in assisting survivors of sexual trauma towards post-traumatic growth. Récupéré de https://digitalcommons.lesley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=expressive_theses le 18 mai 2021.
Duchin, A. et Wiseman, H. (2019). Memoirs of child survivors of the Holocaust: Processing and healing of trauma through writing. Qualitative Psychology, 6(3), 280-296. https://doi.org/10.1037/qup0000128
Frattaroli, J. (2006). Experimental disclosure and its moderators: a meta-analysis. Psychological bulletin, 132(6), 823-865. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.6.823
Hildson, J. (2004). After the session: ‘freewriting’ in response. Dans G. Bolton, S. Howlett, C. Lago et J.K. Wright (dir.), Writing cures. An introductory handbook of writing in counselling and therapy (p. 212-220). Routledge.
Hilse, C., Griffiths, S. et Corr, S. (2007). The impact of participating in a poetry workshop. British Journal of Occupational Therapy, 70(10), 431-438. https://doi.org/10.1177/030802260707001004
Kerner, E.A. et Fitzpatrick, M.R. (2007). Integrating writing into psychotherapy practice: A matrix of change processes and structural dimensions. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44(3), 333-346. https://doi.org/10.1037/0033-3204.44.3.333
King, L.A. (2002). Gain without pain? Expressive writing and self-regulation. Dans S.J. Lepore et J.M. Smyth (dir.), The writing cure. How expressive writing promotes health and emotional well-being (p. 119–134). American Psychological Association.
Kovac, S.H., et Range, L.M. (2000). Writing projects: Lessening undergraduates' unique suicidal bereavement. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 30(1), 50-60. https://doi.org/10.1111/j.1943-278X.2000.tb01064.x
Lauer, R. et Goldfield, M. (1970). Creative writing in group therapy. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 7(4), 248–252. https://doi.org/10.1037/h0086603
Lepore, S.J. et Smyth, J.M. (2002). The writing cure: an overview. Dans S.J. Lepore et J.M. Smyth (dir.), The writing cure. How expressive writing promotes health and emotional well-being (p. 3-14). American Psychological Association.
Liu, R. (2013). “The Things They Carried’’: Unpacking trauma scripts inside a community writing workshop. Counselling Psychology Quarterly, 26(1), 55–71. https://doi.org/10.1080/09515070.2012.728306
Lutgendorf, S.K et Ullrich, P. (2002). Cognitive processing, disclosure, and health: psychological and physiological mechanisms. Dans S.J. Lepore et J.M. Smyth (dir.), The writing cure. How expressive writing promotes health and emotional well-being (p. 177-196). American Psychological Association.
Mégrier, D. et Hamot, A. (2017). Ecrire pour dire, Ecrire pour se dire. Ateliers d’écriture en milieu psychiatrique. Chronique sociale.
Nicholls S. (2009). Beyond Expressive Writing: Evolving Models of Developmental Creative Writing. Journal of Health Psychology, 14(2), 171-180. https://doi.org/10.1177/1359105308100201
Pennebaker, J.W. (1989). Confession, inhibition, and disease. Dans Advances in experimental social psychology (Vol. 22, p. 211-244). Academic Press.
Pennebaker, J.W. (2013). Writing to heal. A guided journal for recovering from trauma and emotional upheaval. Center for Journal Therapy, Inc.
Pennebaker, J.W. et Francis, M.E. (1996). Cognitive, emotional, and language processes in disclosure. Cognition & Emotion, 10(6), 601-626. https://doi.org/10.1080/026999396380079
Pennebaker, J.W. et Smyth, J.M. (2016). Opening up by writing it down. How expressive writing improves health and eases emotional pain (3rd edition). The Guilford Press.
Smyth, J.M. (1998). Written emotional expression: Effect sizes, outcome types, and moderating variables. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 174–184. https://doi.org/10.1037/0022-006X.66.1.174
Smyth, J.M., Hockemeyer, J.R. et Tulloch, H. (2008). Expressive writing and post‐traumatic stress disorder: Effects on trauma symptoms, mood states, and cortisol reactivity. British Journal of Health Psychology, 13(1), 85-93. https://doi.org/10.1348/135910707X250866
Smyth, J.M., True, N. et Souto, J. (2001). Effects of writing about traumatic experiences: The necessity for narrative structuring. Journal of Social and Clinical Psychology, 20(2), 161-172. https://doi.org/10.1521/jscp.20.2.161.22266
Tellier, A. (1998). Expériences traumatiques et écriture. Economica.
Thompson, K. (2004). Journal writing as a therapeutic tool. Dans G. Bolton, S. Howlett, C. Lago et J.K. Wright (dir.), Writing cures. An introductory handbook of writing in counselling and therapy (p. 72-84). Routledge.
Usbeck, F. (2018). Writing Yourself Home: US Veterans, Creative Writing, and Social Activism. European journal of American studies, 13(2). https://doi.org/10.4000/ejas.12567
Uy, K. et Okubo, Y. (2018). Reassembling a shattered life: A study of posttraumatic growth in displaced Cambodian community leaders. Asian American Journal of Psychology, 9(1), 47-61. https://doi.org/10.1037/aap0000111
van Westrhenen, N., Fritz, E., Oosthuizen, H., Lemont, S., Vermeer, A. et Kleber, R.J. (2017). Creative arts in psychotherapy treatment protocol for children after trauma. The arts in Psychotherapy, 54, 128-135. https://doi.org/10.1016/j.aip.2017.04.013
Wright, J.K. (2004). The passion of science, the precision of poetry: therapeutic writing – a review of the literature. Dans G. Bolton, S. Howlett, C. Lago et J.K. Wright (dir.), Writing cures. An introductory handbook of writing in counselling and therapy (p. 7-17). Routledge.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.